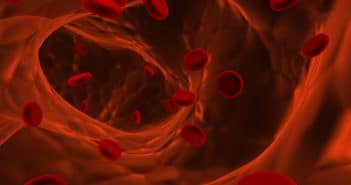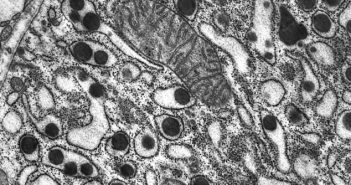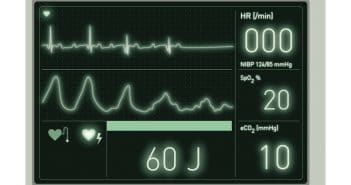L’avancée des anti-Xa
Deux études et plusieurs mises au point ont confirmé les notions déjà entrevues dans les études disponibles; nous allons en effet bientôt disposer de nombreux nouveaux anticoagulants actifs par voie orale qui devraient modifier et probablement simplifier notre pratique. Lors des sessions scientifiques de la Société Européenne de Cardiologie, les résultats de l’évaluation clinique de deux de ces nouvelles molécules du groupe des anti-Xa, l’apixaban et le rivaroxaban, ont été présentés. Bien que les résultats détaillés de ces études n’aient pas été publiés, nous en rapporterons les principaux éléments.