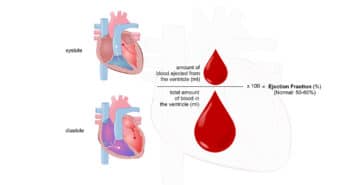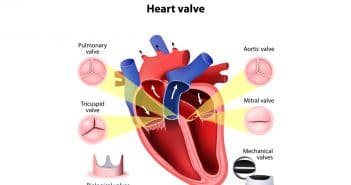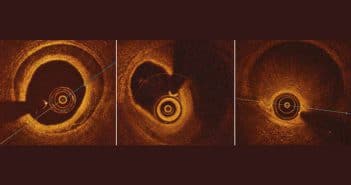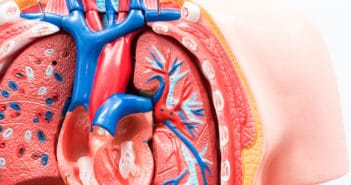
Quantification et traitement du syndrome congestif
La congestion est la principale cause d’hospitalisation chez les patients insuffisants cardiaques. Au cours des 10 dernières années, suite à la prise de conscience de l’importance majeure de la congestion dans le pronostic et la morbidité de l’insuffisance cardiaque, l’évaluation de la congestion s’est notablement raffinée. Une évaluation intégrative de la congestion combinant marqueurs biologiques (peptides natriurétiques et volume plasmatique estimé, calculé à partir de l’hémoglobine et l’hématocrite) et échographiques (veine cave inférieure, PAPS, quantification des lignes B pulmonaires, recherche d’une éventuelle ascite) permet l’identification d’une congestion infraclinique et pourrait modifier notre prise en charge de l’insuffisance cardiaque.
Le traitement de la congestion est principalement basé sur les diurétiques de l’anse et, en cas de résistance aux diurétiques de l’anse, sur les diurétiques thiazidiques. Les méthodes d’épuration extrarénale d’indication purement cardiologique peuvent être envisagées dans des filières de soins d’insuffisance cardiaque sévère dans des cas de résistance extrême aux diurétiques.