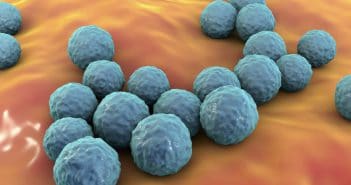Place des anticoagulants oraux directs dans l’artériopathie oblitérante des membres inférieurs
Alors que la physiopathologie prothrombogène de l’athérosclérose suggérait un net bénéfice des associations antithrombotiques chez le sujet artériopathe, les données des différentes études menées jusqu’à présent ont formellement souligné le risque hémorragique accru des antivitamines K (AVK) au long cours dans cette indication.
La découverte des anticoagulants oraux directs (AOD) a représenté une avancée majeure dans le domaine des antithrombotiques. Au moins aussi efficaces que les AVK et responsables de moins d’hémorragies majeures, les AOD sont aujourd’hui le traitement de première intention dans la maladie thromboembolique veineuse et la fibrillation auriculaire non valvulaire.
Les résultats de l’étude COMPASS donnent un nouvel élan à la prévention secondaire des sujets artériopathes et ouvrent de nouvelles voies d’amélioration de leur pronostic général et local.