
La nutrition n’est plus dans son assiette…
“Mais si le monde social a sa rationalité, elle n’est pas celle dont nous arme la pensée cartésienne”
Erik Neveu, In : “Sociologie politique des problèmes publics” Armand Colin, 2015

“Mais si le monde social a sa rationalité, elle n’est pas celle dont nous arme la pensée cartésienne”
Erik Neveu, In : “Sociologie politique des problèmes publics” Armand Colin, 2015

La tachycardie sinusale inappropriée (TSI) est un syndrome dans lequel la fréquence cardiaque (FC) sinusale est, de façon inexplicable, plus rapide qu’attendu et des symptômes associés sont présents. La FC au repos, même en position couchée, peut dépasser 100 battements par minute (bpm) ; une activité minimale accélère la FC rapidement et substantiellement.
Les patients peuvent nécessiter une restriction d’activité physique. Les mécanismes responsables de la TSI sont incomplètement compris.

Le dossier de Réalités Cardiologiques de ce mois de mai s’intéresse à une situation que le cardiologue rencontre de plus en plus fréquemment : l’hypotension orthostatique (hO). Cette épidémiologie s’explique par le vieillissement de la population, l’explosion des cas de diabète et la polymédication, qui constituent les trois situations les plus souvent associées à l’hO. Le dépistage est crucial car l’hO constitue un facteur de risque des maladies cérébro et cardiovasculaires mais aussi de la morbidité et de la mortalité totale (du fait des chutes et des comorbidités associées). La prise en charge est symptomatique mais nécessite parfois le recours à des traitements adaptés plus complexes.

Une bonne connaissance de la physiopathologie de l’hypotension orthostatique permet une prise en charge intelligente et optimale de cette pathologie.
L’orthostatisme modifie la répartition de la volémie et introduit la pression hydrostatique dans l’hémodynamique. Le maintien de la pression artérielle devient critique dans cette position. Une régulation est mise en œuvre principalement par la branche sympathique du système nerveux autonome. Mais d’autres mécanismes sont sollicités comme la pompe musculaire et le réflexe veinolo-artériolaire.

L’hypotension orthostatique (HO) se définit par consensus comme une diminution persistante de la pression artérielle d’au moins 20 mmHg pour la pression systolique ou 10 mmHg pour la pression diastolique, survenant dans les 3 premières minutes après le lever.
L’HO est fréquente et sa prévalence augmente avec l’âge. Elle représente un facteur de morbimortalité. La principale cause est iatrogène. L’HO peut être aussi neurogène et doit être recherchée dans certaines populations à risque (diabète, syndromes parkinsoniens…).
Les signes cliniques peuvent être évocateurs (sensation de tête vide, flou visuel, malaise pouvant aller jusqu’à la syncope) ou non spécifiques (fatigue, faiblesse…). Une analyse précise des circonstances de survenue aidera à identifier l’HO comme facteur causal.

Outre la morbidité liée aux chutes ou aux syncopes, l’hypotension orthostatique (Ho) constitue un facteur de risque de maladies cérébrovasculaires mais aussi de mortalité. Sa prise en charge fait d’abord appel à des mesures non médicamenteuses, à l’éducation du patient et à l’éviction (ou à la limitation des posologies) des médicaments imputables. Le recours au médicament nécessite une évaluation approfondie du risque cardiovasculaire, et ne peut se concevoir que dans le cadre d’une approche multidisciplinaire.
Parmi les médicaments destinés à l’Ho, et selon les recommandations actuelles, la midodrine et la fludrocortisone sont les médicaments de première intention, bien que seule la midodrine ait été évaluée dans des essais cliniques de qualité. Les autres médicaments disponibles sont soit inefficaces (analeptiques cardiovasculaires), soit n’ont pas d’AMM en France dans cette indication (érythropoïétine, desmopressine, droxidopa).
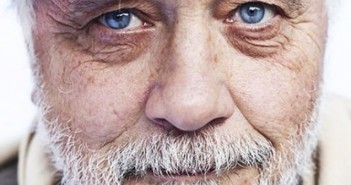
La prévalence de l’hypotension orthostatique augmente avec l’âge, elle atteint 25 % au-delà de 85 ans. Sa prévalence dépend aussi de l’autonomie et de la présence de comorbidités. L’hypotension orthostatique représente un marqueur de vulnérabilité chez le sujet âgé.
Les recommandations de la Société française d’HTA et de la Société française de gériatrie soulignent que “Il est recommandé de rechercher systématiquement une hypotension orthostatique chez les personnes âgées de plus de 65 ans”. Ce dépistage est important en raison des conséquences graves qu’elle peut engendrer. Chez le sujet âgé, les étiologies de l’hypotension orthostatique sont nombreuses et souvent intriquées. Le plus souvent il s’agit d’une cause secondaire (médicamenteuse et/ou hypovolémie), parfois une origine neurogène peut être associée.
La prise en charge repose sur l’éviction ou le traitement de la cause et sur les mesures non médicamenteuses. Parfois, un traitement pharmacologique par midodrine peut être proposé pour les hypotensions orthostatiques symptomatiques d’origine neurogène.

Le texte qui suit est rédigé en accord avec le Consensus d’experts de la Société Française d’Hypertension Artérielle “Prise en charge de l’hypotension orthostatique”. Celles-ci ont été écrites par A. Pathak, J.-L. Elghozi, J.-M. Sénard et J.-O. Fortrat. Ce Consensus a été revu par O. Hanon et J.-M. Halimi et approuvé par un groupe d’experts.
En introduction, 3 QCM camperont l’hypotension orthostatique abrégée en hO. Ensuite, seront abordés les médicaments susceptibles d’induire une hO avec 1 QCM, 4 histoires cliniques et un exercice. Ce sera ensuite les hO neurogènes avec 1 cas clinique, et nous terminerons par les médicaments de l’hO avec 1 QCM. Les réponses se trouvent à la fin du texte avec les commentaires ad hoc qui permettent des rappels.
À vos crayons, stylos, marqueurs, voire plumes d’oie !

Les résultats de l’étude SIGNIFY ont été publiés en 2014 dans le New England Journal of Medicine. Dans cette étude, l’ivabradine n’a pas modifié significativement le critère primaire composite de décès cardiovasculaire ou d’infarctus du myocarde non fatal.
Ce résultat neutre peut s’expliquer par un schéma thérapeutique particulier, mais également par des coprescriptions d’inhibiteurs calciques bradycardisants et d’inhibiteurs puissants du CYP3A4 qui ont conduit à un pourcentage important de bradycardies.
Après SIGNIFY, la cible thérapeutique de fréquence cardiaque chez le patient présentant une cardiopathie ischémique stable est de 60 à 70 battements par minute.

L’insuffisance mitrale (IM) dystrophique (dégénérative) est actuellement la plus prévalente des IM primaires, avec 60-70 % des cas, et regroupe un grand spectre de présentations.
L’indication chirurgicale chez les patients avec une IM sévère symptomatique ou une dysfonction ventriculaire gauche fait l’objet d’un large consensus. En revanche, chez les patients asymptomatiques, l’identification de facteurs de mauvais pronostic est primordiale pour démasquer les patients pouvant bénéficier d’une intervention précoce.
L’échocardiographie est la pierre angulaire de la prise en charge de ces patients. Elle permet d’évaluer la sévérité au repos et à l’effort de la régurgitation, les répercussions sur les ventricules gauche et droit, les pressions pulmonaires et l’oreillette gauche. Cet article fera la revue des nouveaux indices pronostiques permettant d’optimiser la stratification du risque chez les patients asymptomatiques avec IM sévère.
