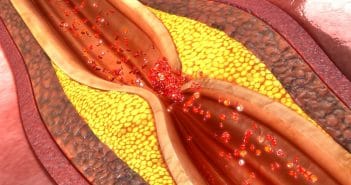Chirurgie et indication opératoire dans les bicuspidies
La plastie aortique s’adresse aux patients porteurs d’une insuffisance aortique dystrophique à valves souples non rétractées bicuspides ou tricuspides, avec ou sans anévrysme conformément aux recommandations européennes ESC/EACTS 2017 avec prise en charge dans un centre expert. Elle se justifie car la mortalité à 15 ans d’une bioprothèse aortique est de 30 % et de 26 % pour une valve mécanique chez les patients de 45-54 ans, alors que celle des conservations valvulaires aortiques est de 10 % avec une meilleure qualité de vie et une espérance de vie similaire à celle de la population générale.
La plastie aortique des valves bicuspides donne de très bons résultats superposables à ceux des valves aortiques tricuspides, dont le taux de réopération est inférieur à 10 % à 15 ans. Lorsqu’une plastie n’est pas possible, l’intervention de Ross (autogreffe pulmonaire) se justifie jusqu’à 45 ans, car c’est le seul substitut valvulaire permettant d’avoir une espérance de vie similaire à celle de la population générale.