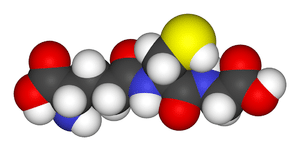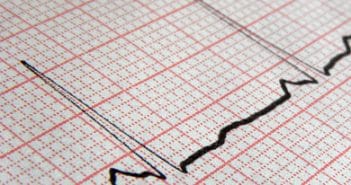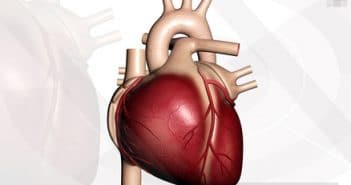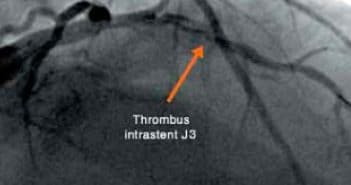Pronostic de l’insuffisance cardiaque à FE préservée
Le pronostic de l’IC à FE préservée est beaucoup plus proche de celui de l’IC à FE altérée qu’il n’était auparavant considéré, c’est-à-dire aussi péjoratif, que ce soit en termes de mortalité ou de réadmission. Les derniers registres montrent des taux de mortalité autour de 20 % un an après une décompensation, et entre 50 et 60 % à 5 ans. Cela incite à étudier davantage cette entité, longtemps sous-estimée et oubliée des grands essais cliniques, sans oublier que la tâche est compliquée par son importante hétérogénéité et le poids qu’y ont l’âge et les comorbidités. Contrairement à l’IC à FE altérée, le pronostic de l’IC à FE préservée ne s’améliore pas et sa prise en charge semble moins optimale.