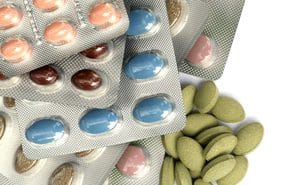Les dermatoses paranéoplasiques
Les dermatoses paranéoplasiques doivent être bien connues du dermatologue mais aussi de tous les internistes en raison de leur grand intérêt diagnostique. Elles peuvent être un signe de découverte d’un cancer profond inconnu et permettent un traitement précoce de ce dernier. Elles peuvent être un signe de récidive d’un cancer connu et traité. Hélas, le plus souvent elles sont le signe d’accompagnement d’un cancer connu évolué.
Pour cette revue, nous utiliserons la classification probabiliste des dermatoses paranéoplasiques.