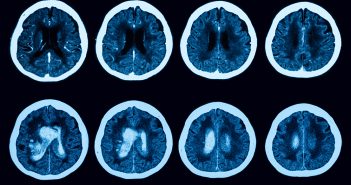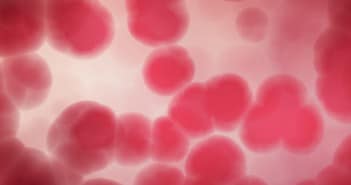Pourquoi et comment rechercher la FA silencieuse après ablation ?
Le principal avantage de l’ablation de la fibrillation atriale (FA) résidant dans la réduction des symptômes, l’utilité d’un monitoring ECG des patients asymptomatiques après ablation peut être débattue. Après ablation, l’incidence des épisodes de FA asymptomatique varie entre 0 et 20 %. Plus les durées de monitoring ECG sont longues, plus les taux de dépistage de FA sont élevés. Les moniteurs implantables sous-cutanés permettent donc d’identifier les épisodes moins fréquents de FA.
Les patients vus dans le cadre d’essais cliniques ou chez lesquels l’anticoagulant pourrait être arrêté doivent ainsi avoir une surveillance rapprochée pour dépister la FA silencieuse. Cependant, la détection ou non de FA silencieuse ne doit pas déterminer une approche différente pour la stratégie antiarythmique ni pour l’anticoagulation qui reste, pour le moment, basée sur le score CHA2DS2-VASc. La détection des arythmies atriales silencieuses permet cependant de mieux appréhender le risque de récidives à long terme et les éventuels moyens à mettre en œuvre compte tenu des mécanismes électrophysiologiques qui en sont potentiellement responsables.