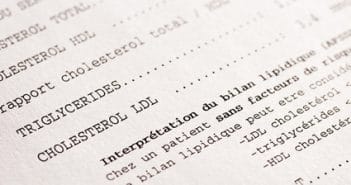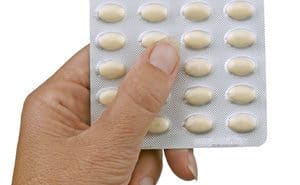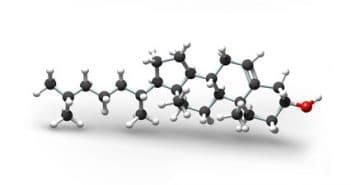Chez l’insuffisant rénal terminal, le phosphore doit être considéré comme un facteur de risque cardiovasculaire. Chez les patients à fonction rénale normale ou subnormale, il peut être surtout le témoin de ce risque parce qu’il s’associe souvent à d’autres facteurs de risque d’athérosclérose. Il favorise cependant la rigidité artérielle. Le phosphore étant quantitativement élevé dans une alimentation occidentale fort riche, la relation entre cet ion et le risque cardiovasculaire n’est peut-être qu’indirecte. Pour prouver le rôle direct du phosphore sur le risque cardiovasculaire, il est nécessaire d’initier des études à plus grande échelle, prospectives et contrôlées, en connaissant l’alimentation des patients, leurs traitements et comorbidités et divers paramètres biologiques (lipidiques par exemple) à côté de la phosphorémie à déterminer à jeun.