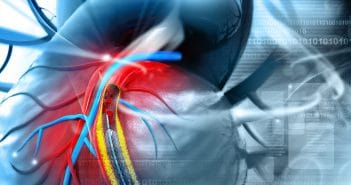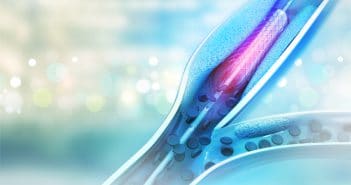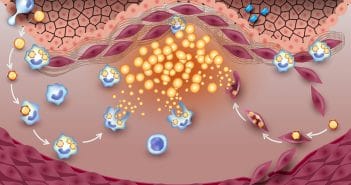Quelle imagerie en première ligne en cas de douleurs thoraciques (troponines négatives) : troponines ultrasensibles et rien d’autre ?
Plusieurs techniques d’imagerie permettent d’aider au diagnostic de la maladie
coronaire chez les patients hospitalisés aux urgences pour douleur thoracique aiguë, avec
ECG et troponines “classiques” normales.
Les troponines ultrasensibles ou hautement sensibles (HS-TN) permettent quant à elles
d’améliorer la sensibilité du test au prix d’une perte de la spécificité. Cependant, ce dosage
utilisé en respectant les algorithmes des recommandations européennes et en l’intégrant
notamment à l’évaluation clinique, permet de trier plus de 50 % des patients.