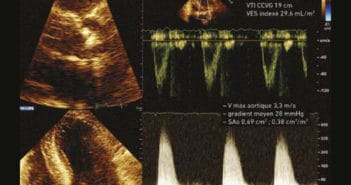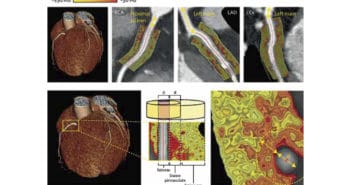Quand et pourquoi doser la Lp(a) ?
La Lp(a) est une lipoprotéine athérogène dont l’intérêt rebondit actuellement en raison de nouvelles thérapeutiques prometteuses permettant de réduire le taux circulant de façon très importante. Cette lipoprotéine connue depuis de nombreuses décennies est associée de manière indépendante au risque de morbi-mortalité coronaire, d’accident vasculaire cérébral ischémique et de rétrécissement aortique. Son dosage est recommandé (non remboursé en France) chez les patients en prévention primaire à très haut risque et au moins une fois dans la vie (la Lp(a) est déterminée génériquement et un seul dosage suffit) chez ceux avec des antécédents de maladie coronaire ou cérébrale ischémique précoce, et en prévention secondaire chez les récidivistes bien que sous traitement par statine.
Il est nécessaire d’attendre les études de phase III visant à réduire le risque de maladie athérosclérotique chez des patients en prévention secondaire avec une élévation de la Lp(a) pour pouvoir associer ce traitement à l’arsenal thérapeutique hypolipémiant (statine, ézétimibe, anti-PCSK9) actuellement disponible.