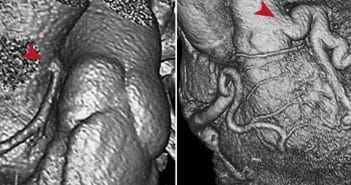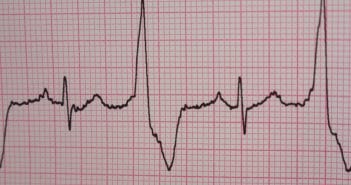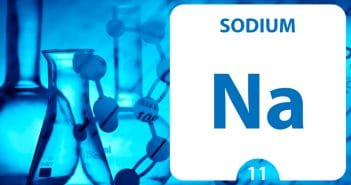Tabac chauffé : un nouveau leurre de l’industrie du tabac
Le tabac chauffé est un produit du tabac dont les émissions recueillies dans les machines à fumer contiennent des concentrations moindres de substances cancérogènes, mutagènes et génotoxiques par rapport aux cigarettes classiques. Cependant, à ce jour, une réduction des risques pour le consommateur n’est en rien démontrée.
Le tabac chauffé, contrairement aux produits de la vape, est un produit nuisible à la santé, conçu pour favoriser l’inoculation et le maintien de la dépendance tabagique, une maladie chronique mortelle dans 50 % des cas. Le principal danger n’est pas lié au produit, qui n’est pas suspecté d’être plus toxique que la cigarette, mais à sa commercialisation très agressive. Le tabac chauffé est un leurre de l’industrie du tabac pensé et créé pour entretenir la consommation du tabac fumé, en jouant en particulier sur la confusion avec la vape.