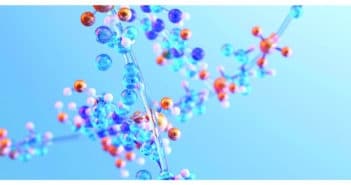Quoi de neuf en numérique, santé connectée et intelligence artificielle ?
Une nouvelle ère médicale s’ouvre avec l’arrivée des technologies numériques et de l’intelligence artificielle. La santé connectée repose sur les applications mobiles, les capteurs portables et les dispositifs médicaux connectés, facilitant la surveillance en temps réel des patients et l’amélioration des soins. L’IA, notamment via le machine learning et le deep learning, joue un rôle clé dans l’analyse des données médicales, l’automatisation des tâches et le soutien aux décisions cliniques, tout en présentant des défis en matière d’intégration clinique et de transparence. La télésanté, qui inclut la téléconsultation, la télésurveillance et le télésoin, élargit l’accès aux soins, particulièrement pour les patients atteints de maladies chroniques. Toutefois, le développement de ces technologies nécessite qu’une attention particulière soit prêtée à la sécurité des données, à la transparence des algorithmes et à la supervision humaine pour garantir un usage éthique et sécurisé. La transformation numérique des soins de santé est prometteuse mais doit être équilibrée pour maximiser ses bénéfices tout en gérant les risques associés.