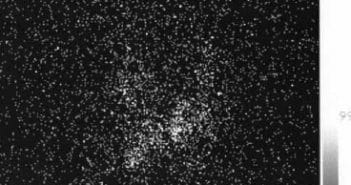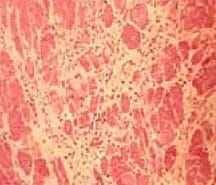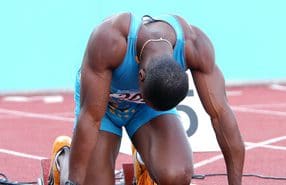Mise à l’insuline des patients diabétiques de type II et prise de poids
C’est un lieu commun que de dire que “l’insuline fait grossir”. Comme toute idée reçue, cette assertion mérite d’être revisitée pour être estimée à sa juste importance. Pour comprendre ce qui se passe, il faut affronter un paradoxe apparent :
– l’insuline par elle-même ne fait pas grossir : c’est notre thèse,
– la mise à l’insuline des diabétiques de type II s’accompagne souvent d’une prise de poids, parfois considérable.