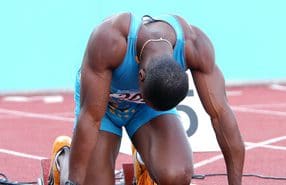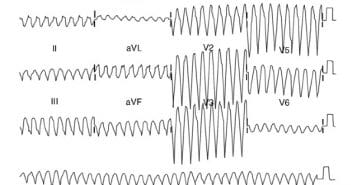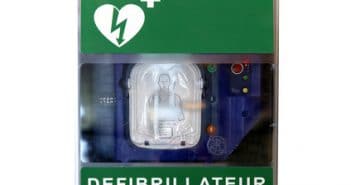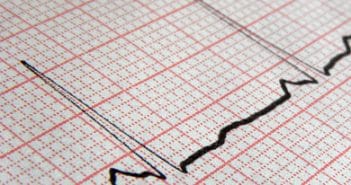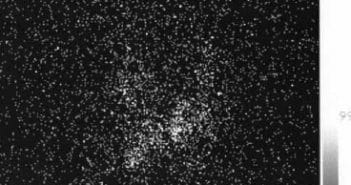
Suivi de la TSH et amiodarone
Le dosage de TSH doit être systématique avant la mise sous amiodarone, y compris en situation d’urgence. Il est suffisant pour confirmer l’euthyroïdie. Dans ce cas, et en l’absence d’antécédents thyroïdiens, un contrôle de la TSH tous les 6 mois est indispensable, le temps de la durée du traitement mais aussi jusqu’à 1 an à 18 mois après l’arrêt de l’amiodarone. La formule biologique normale d’un sujet sous amiodarone dans les 3 premiers mois de traitement est: T4 libre élevée, T3 libre basse ou normale basse, TSH modérément élevée. Une simple élévation de la T4 libre n’est pas synonyme d’hyperthyroïdie. Après 3 mois de prise d’amiodarone, la TSH se normalise. Tout écart de cette formule impose de prendre l’avis d’un endocrinologue, de s’interroger sur le caractère indispensable ou non du traitement par amiodarone, et de prendre l’avis du cardiologue qui a prescrit ce traitement.