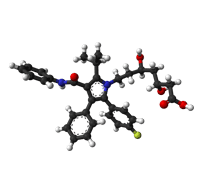Objectifs de LDL à 0,7 g/L: pour quel coronarien ?
Des études ont démontré le bénéfice d’une réduction du LDL-cholestérol jusqu’à 0,70 g/L chez certains patients à très haut risque en prévention secondaire de l’infarctus du myocarde. L’emploi de fortes doses de statines (par rapport aux doses conventionnelles) pendant les deux ans qui suivent un syndrome coronarien aigu réduit essentiellement la mortalité totale et le nombre de revascularisations, mais pas le nombre d’infarctus du myocarde et d’accidents vasculaires cérébraux. Chez les patients coronariens stables, le bénéfice sur 5 ans porte sur la baisse du nombre d’infarctus du myocarde et d’accidents vasculaires cérébraux, et sur la diminution des revascularisations, mais non sur la mortalité totale ou les ré-hospitalisations. D’un point de vue pratique, il convient de s’en tenir aux recommandations de l’AFSSAPS, mais le louable “Primum non nocere” ne doit pas conduire à sous-utiliser de façon irrationnelle ces médicaments (sous dosage ou non prescription) sous peine de risquer de ne pas sauver un nombre important de patients, sous prétexte d’éviter un risque minime.