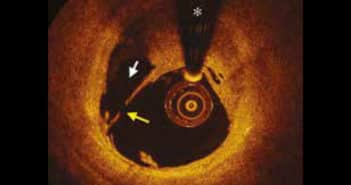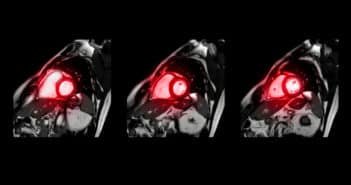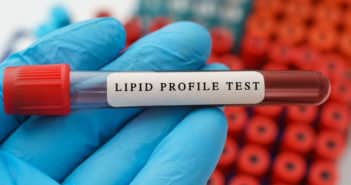Conduite à tenir devant un trouble du rythme chez un patient resynchronisé
La resynchronisation est une thérapeutique très efficace en termes fonctionnel et de morbi-
mortalité. Les troubles du rythme (principalement fibrillation atriale et extrasystoles ventriculaires) sont un facteur fréquent de mauvaise réponse à la resynchronisation, d’une part, en diminuant la “dose” de stimulation biventriculaire reçue par le patient qui doit être proche de 100 % du temps pour être pleinement efficace (en pratique supérieure à 97 %) et, d’autre part, en raison de leur retentissement direct sur la fonction ventriculaire gauche.
Une approche très active, voire agressive, du maintien du rythme sinusal est indiquée chez ces patients, d’autant plus que le trouble du rythme est mal toléré et participe à la dégradation hémodynamique.
L’ablation de fibrillation atriale et de flutter ainsi que l’ablation des foyers d’extrasystoles ventriculaires sont des thérapeutiques de choix à proposer au patient après discussion entre cardiologue traitant, cardiologue spécialiste de l’insuffisance cardiaque et cardiologue rythmologue.