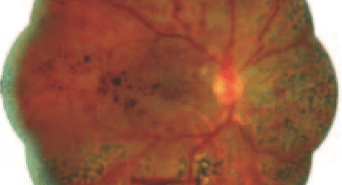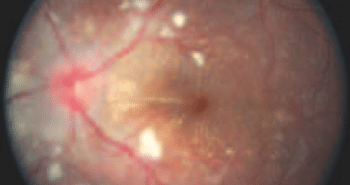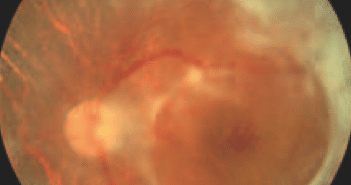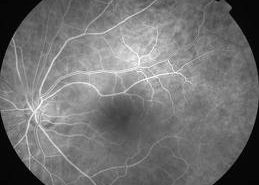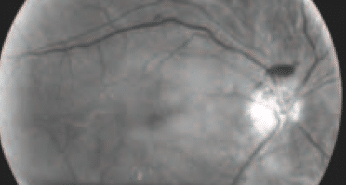Explorations non invasives de l’AOMI
Une fois posé le diagnostic d’artériopathie des membres inférieurs par la clinique et la mesure de l’IPS, les méthodes d’imagerie non invasives permettent de dresser une cartographie lésionnelle précise.
A ce stade, sauf exception, l’artériographie conventionnelle n’a plus de place.
L’écho-Doppler, l’angioscanner et l’angiographie par résonance magnétique sont les méthodes de choix pour cette exploration. Le choix entre ces différentes méthodes va dépendre en grande partie de leur disponibilité et de l’expérience du centre concerné.
Les différentes recommandations mettent chacune de ces méthodes au même niveau. Elles contribuent très largement au choix de la stratégie thérapeutique.