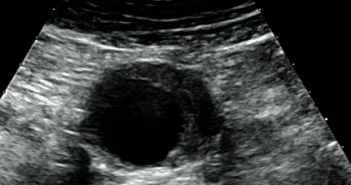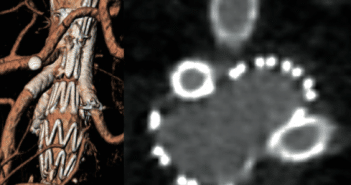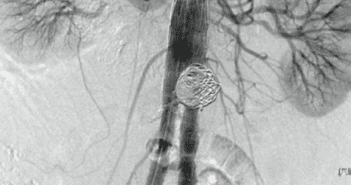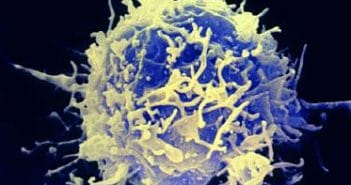Occlusions veineuses rétiniennes : quel bilan, quel pronostic, quels traitements ?
La prise en charge des occlusions veineuses rétiniennes (OVR) a été récemment bouleversée par l’arrivée dans la pharmacopée de deux nouveaux traitements de l’œdème maculaire (OM) (fig. 1). Si l’administration de ces traitements est maintenant bien codifiée, il est important de faire une évaluation complète de l’OVR pour placer ce traitement de l’œdème parmi les autres modalités de prise en charge plus classiques des OVR qui gardent leur indications respectives, comme le traitement dit “étiologique” et le traitement de la composante ischémique par laser. Ces différentes avancées dans le domaine des OVR ont fait l’objet du Rapport des Sociétés d’ophtalmologie de France en novembre 2011 [1].