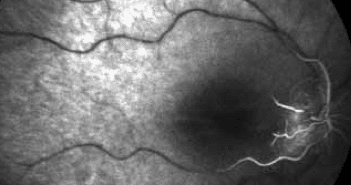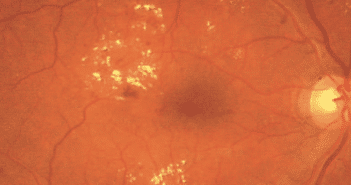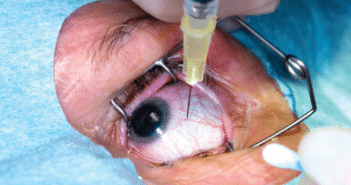Manifestations cutanées du syndrome des antiphospholipides
Les lésions dermatologiques du syndrome des antiphospholipides (SAPL) sont fréquentes et parfois inaugurales. Elles sont diverses dans leur expression clinique, allant de manifestations très discrètes – souvent non remarquées et non diagnostiquées – à des lésions sévères, pouvant mettre en jeu le pronostic vital telles que les nécroses cutanées extensives ou les gangrènes distales. Le livedo est la lésion dermatologique la plus fréquente, marqueur du phénotype artériel du syndrome.
Des lésions cutanées sont observées dans la moitié des cas de syndrome catastrophique des antiphospholipides, heureusement rare (1 %), caractérisé par la survenue en moins d’une semaine de l’atteinte de 3 organes ou tissus avec thromboses de la microcirculation. Les phlébites superficielles ont été exclues des critères de classification du SAPL où seuls les taux moyens ou élevés des taux d’anticorps anticardiolipine et d’anticorps anti-β2 glycoprotéine 1 sont pris en considération s’ils sont présents à 12 semaines d’intervalle.
Les prises en charge curative et préventive des lésions dermatologiques du SAPL dépendent de leur gravité et de la présence d’autres manifestations du SAPL.