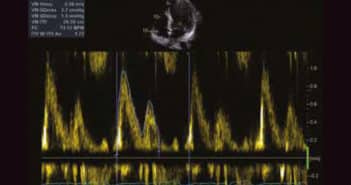Discordance patient-prothèse
La discordance patient-prothèse (Prosthesis-Patient mismatch : PPM) correspond à une inadéquation entre la taille de la prothèse valvulaire implantée (ou de la réparation valvulaire) et la surface corporelle du patient (la surface fonctionnelle valvulaire est trop petite). Bien qu’elle fonctionne normalement, la prothèse est donc sténosante, et présente une élévation des gradients pour un débit cardiaque normal. Cette situation clinique intéresse surtout la valve aortique chez l’adulte, mais peut également se rencontrer après remplacement ou réparation valvulaire mitrale, plus rarement tricuspide ou pulmonaire. Un PPM sévère de la valve aortique (< 0,65 cm²/m²) se rencontre chez 5-10 % des patients après remplacement valvulaire chirurgical ou TAVI, mais apparaît moins fréquent après TAVI, sauf dans les procédures intra-prothétique (VinV). Un PPM sévère est associé à la persistance de symptômes, au risque d’insuffisance cardiaque, et à une augmentation de la morbi-mortalité post-opératoire précoce et tardive. Le PPM peut être prédit en se basant sur la taille de l’anneau aortique et la surface fonctionnelle attendue de la prothèse, publiée dans la littérature. En cas de risque de PPM sévère, le choix de la prothèse/geste valvulaire sera déterminant afin d’éviter sa survenue.