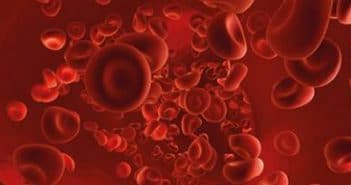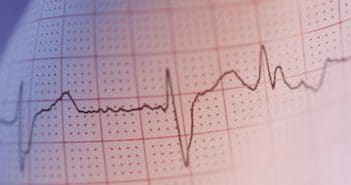Syncopes ou épilepsies : les formes frontières
Les syncopes et les crises épileptiques sont, avec les crises psychogènes, les principales causes de perte de connaissance. Les frontières entre ces phénomènes ne sont pas toujours simples.
D’une part, les syncopes s’accompagnent de signes neurologiques subjectifs et objectifs parfois trompeurs, comme les myoclonies. D’autre part, certaines crises épileptiques peuvent ressembler à des syncopes (notamment vagales) ou même entraîner une syncope par l’activation du système parasympathique central.
Cette complexité potentielle des interactions cœur/cerveau doit être connue et est susceptible de faire l’objet de réunions multidisciplinaires dans les cas de diagnostic difficile.