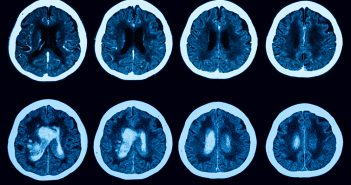Quels seuils proposer aujourd’hui pour la définition et la prise en charge de l’HTA ?
Depuis 50 ans, les recommandations internationales se sont multipliées, s’accompagnant le plus souvent d’une baisse du seuil définissant l’hypertension artérielle (HTA) et du niveau tensionnel à atteindre. En effet, si depuis bientôt 20 ans l’HTA est définie par une pression artérielle (PA) supérieure à 140/90 mmHg (sauf dans les dernières recommandations américaines de 2017 : PA ≥ 130/80 mmHg), l’objectif tensionnel s’est précisé pour atteindre en cas de bonne tolérance une PA inférieure à 130/80 mmHg mais supérieure à 120/70 mmHg (seuil inférieur non mentionné pour les recommandations américaines) et une PA située entre 130 et 139/80 mmHg pour les patients de plus de 65 ans. Ces seuils diffèrent aussi suivant la population étudiée.
Les techniques de mesure de la PA en dehors du cabinet sont désormais mises en avant mais nécessitent d’utiliser des seuils adaptés à chaque technique. Malheureusement, moins d’un hypertendu sur deux a une PA inférieure à 140/90 mmHg sans aucune amélioration en France, et ce depuis plus de 10 ans.