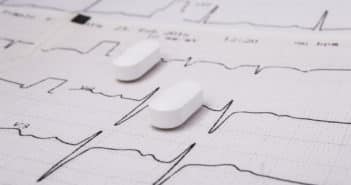Que faire en cas d’insuffisance mitrale associée à un rétrécissement aortique ?
L’association d’une insuffisance mitrale (IM) et d’un rétrécissement aortique (RA) est fréquemment retrouvée du fait de l’augmentation de l’étiologie dégénérative. L’IM peut aussi être secondaire à l’évolution de la pathologie aortique. Elle pose de multiples problèmes diagnostiques pour évaluer précisément la sévérité de chacune des valvulopathies. Les différentes formes cliniques et échocardiographiques doivent être connues pour proposer le traitement le plus adapté.
Nous discuterons de l’impact pronostique de cette double valvulopathie, des limites diagnostiques en échocardiographie et des solutions apportées par l’imagerie multimodalité, et enfin des possibilités de prise en charge thérapeutique.