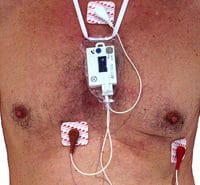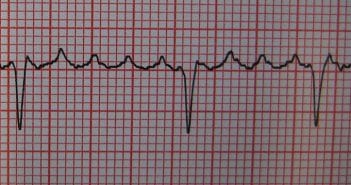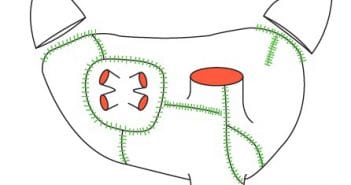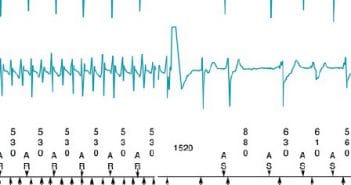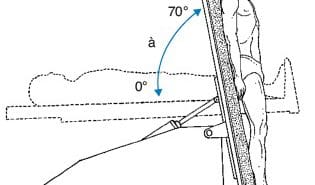Faut-il rétablir l’usage de l’hyperglycémie provoquée orale dans la panoplie d’évaluation du risque vasculaire en cardiologie ?
A un moment où la plupart des instances internationales et nationales de diabétologie et endocrinologie recommandent de faire reposer le diagnostic de diabète exclusivement sur la glycémie à jeun, rejetant à des circonstances particulières le recours à l’hyperglycémie provoquée orale (HGPO), un certain nombre d’articles ou de recommandations très récents remettent en question cette position et reposent le problème de l’utilité de cet examen. Le lecteur est engagé à se reporter à l’encadré ci-dessous pour avoir une revue bibliographique non exhaustive des publications les plus récentes qui assoient le renouveau (?) d’intérêt pour le test de charge orale en glucose. Nous allons nous efforcer, dans les lignes qui suivent, de clarifier la situation et nous risquer à des propositions concrètes.