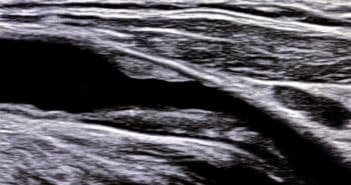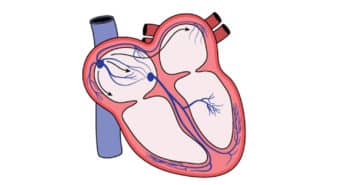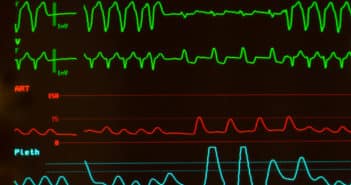Quoi de neuf dans les valvulopathies ?
Les valvulopathies sont une des premières causes de mortalité cardiovasculaire. Avec une prévalence en augmentation, elles sont considérées aujourd’hui comme une nouvelle épidémie cardiaque. En effet, des études post-mortem ont suggéré que la mortalité associée aux valvulopathies a été pendant très longtemps sous-estimée dans les études épidémiologiques [1]. Les valvulopathies rhumatismales sont encore la principale cause de valvulopathie au niveau mondial. En Europe, les valvulopathies dégénératives sont devenues prédominantes, notamment le rétrécissement aortique dont la prévalence et le nombre de décès associés augmentent au cours du temps.