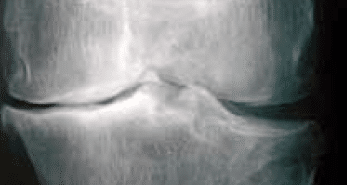Faut-il avoir peur des sucres chez l’enfant ?
L’excès de sucres chez l’enfant occasionne une véritable peur phobique chez un grand nombre de parents et de professionnels de santé, notamment en raison du risque d’obésité qu’il ferait encourir.
Dans cet article, chacun des arguments motivant cette peur est analysé en se basant sur les données objectives de la littérature scientifique. Il résulte de cette analyse que la peur des sucres est clairement démesurée chez l’enfant. Quant à leur surconsommation, parfois rapportée chez les enfants obèses, elle est la conséquence des ingesta accrus de ces enfants, mais en aucun cas la cause de la maladie.