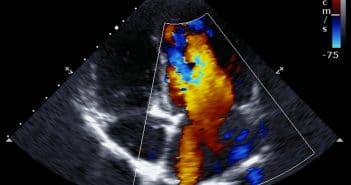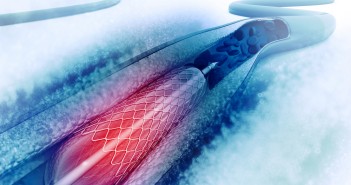L’insuffisance cardiaque à 80 ans : quel traitement ?
L’insuffisance cardiaque des patients de plus de 80 ans a fait l’objet de peu de travaux spécifiques alors qu’elle représente un vrai problème de santé publique dans les pays occidentaux, l’âge moyen des insuffisants cardiaques en France étant de 79 ans.
En effet, cette population reste largement sous-représentée au cours des essais cliniques, lesquels incluent des patients trop jeunes, le plus souvent monopathologiques. Dans sa forme à fraction d’éjection altérée (ICFEA), son traitement doit obéir à de solides recommandations qui ne tiennent pas compte de l’âge ; il est basé sur l’utilisation des bloqueurs des systèmes neuro-hormonaux, rénine-
angiotensine-aldostérone et sympathique, et des diurétiques.
Quant au traitement de l’insuffisance cardiaque à fraction d’éjection préservée (ICFEP), il reste avant tout étiologique, les essais cliniques s’étant jusqu’à présent révélés négatifs. Dans tous les cas, il doit tenir compte des modifications pharmacologiques liées à l’âge et nécessite une surveillance biologique rigoureuse.