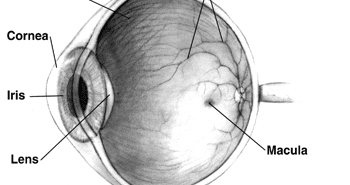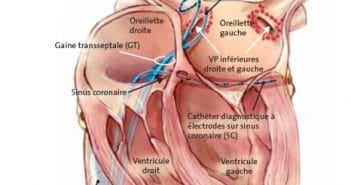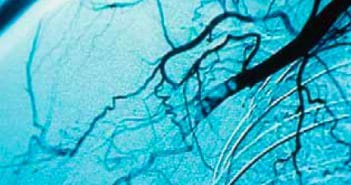Bioprothèses et prothèses mécaniques : la discussion a-t-elle encore lieu d’être ?
La valve idéale qui associerait des performances hémodynamiques excellentes à une longue durabilité sans nécessité d’un traitement anticoagulant n’existe pas encore. Le patient, son cardiologue et son chirurgien doivent dès lors choisir entre une valve mécanique ou biologique.
La dernière décennie a vu la proportion de valves biologiques implantées ne faire qu’augmenter pour dépasser largement celle des mécaniques. Cette évolution s’explique principalement par un vieillissement de la population opérée, un changement des pratiques chirurgicales valvulaires et une évolution considérable des bioprothèses qui sont devenues de plus en plus fiables.
La liberté de décision laissée aux médecins dans les recommandations internationales actuelles reste grande. Ceux-ci ont le devoir d’informer de manière précise et loyale le patient qui doit en définitive rester maître de la décision finale de choix prothétique.