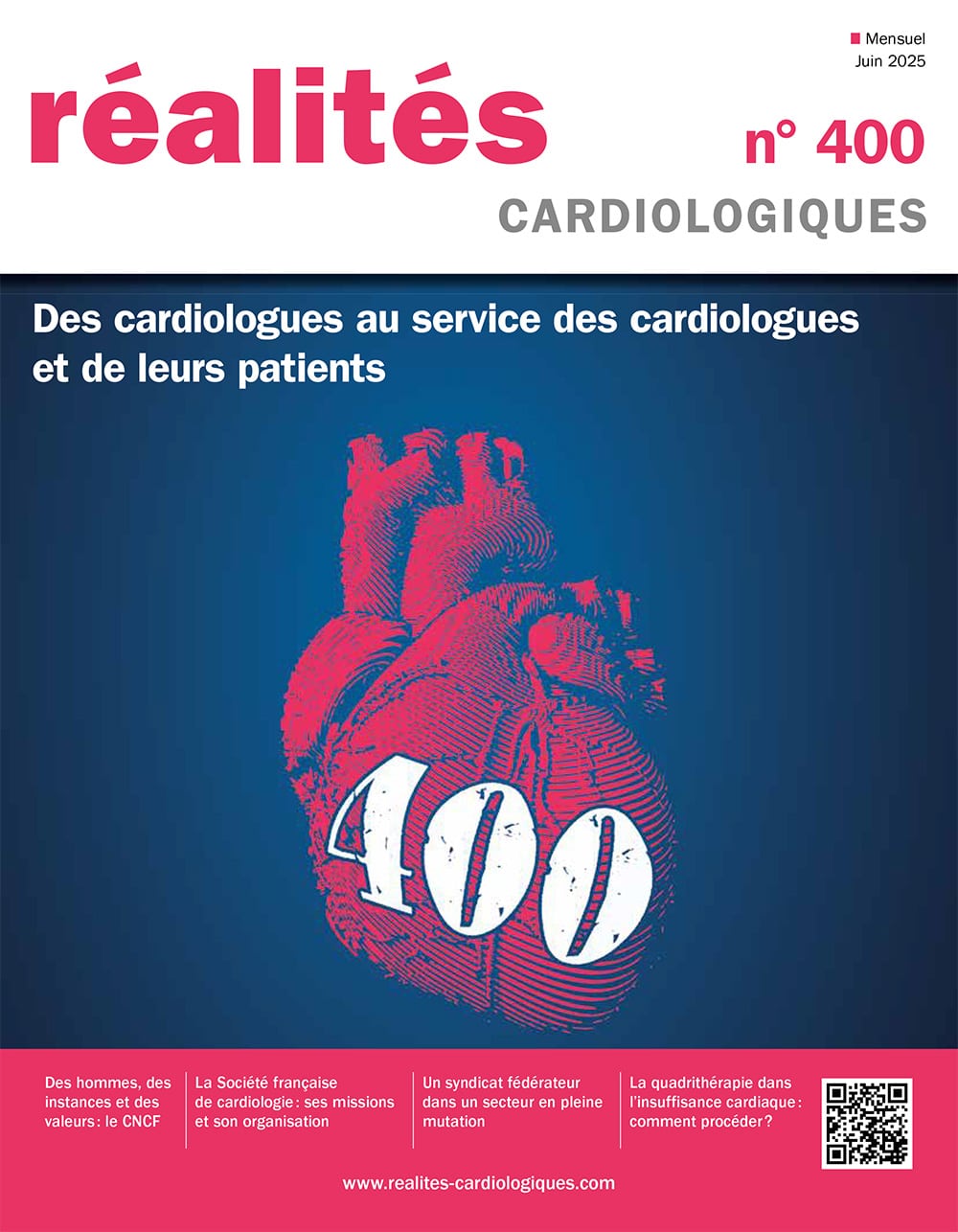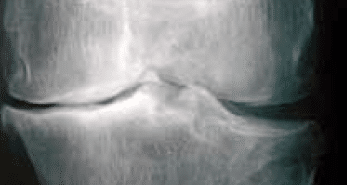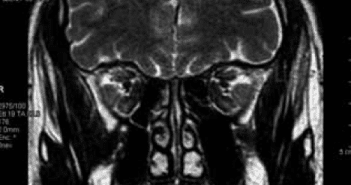
Maladie de Basedow et ophtalmologie : les points essentiels
L’orbitopathie dysthyroïdienne (OT) est une affection auto-immune survenant dans un contexte de dysthyroïdie, le plus souvent dans le cadre d’une maladie de Basedow. Elle altère la qualité de vie des patients, est plus fréquente chez la femme, et demande une prise en charge associant endocrinologues et ophtalmologistes. L’examen clinique apprécie l’activité de la maladie sur l’existence et l’importance des signes inflammatoires, et la sévérité, fonction des désordres fonctionnels et cosmétiques. Dans tous les cas, le traitement est médical et associe l’équilibre de la fonction thyroïdienne, l’arrêt du tabac et des mesures locales (traitements lubrifiants, soins oculaires). S’il existe une inflammation importante, le traitement repose sur la corticothérapie, actuellement prescrite préférentiellement par voie veineuse et dont les modalités ont été établies par l’EUGOGO. Les formes graves sont plus fréquentes chez les hommes âgés et les fumeurs. Le traitement des séquelles fonctionnelles et cosmétiques est envisagé sur des formes non inflammatoires après 6 mois d’équilibre de la fonction thyroïdienne