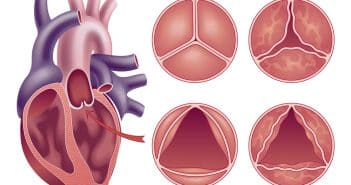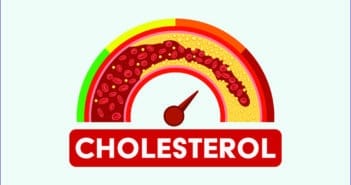Focus sur le syndrome coronaire aigu sans sus-décalage du segment ST
Bien que les dernières recommandations européennes tendent à unifier le spectre des syndromes coronariens aigus (SCA) avec et sans sus-décalage du segment ST, le SCA ST- présente des spécificités tant sur le plan diagnostique, avec le rôle central du dosage de la troponine selon un algorithme 0/1 h, que sur le plan thérapeutique, avec l’absence de prétraitement antiplaquettaire systématique.
Néanmoins, l’approche globalisée des syndromes coronariens aigus reste pertinente dans le cadre de la prévention secondaire, où traitements antiplaquettaires et cardioprotecteurs jouent un rôle clé pour réduire le risque ischémique. à long terme, les bénéfices de cette prévention reposent sur la mise en œuvre de stratégies médicales personnalisées tenant compte des caractéristiques cliniques et angiographiques des patients, et de leurs comorbidités.