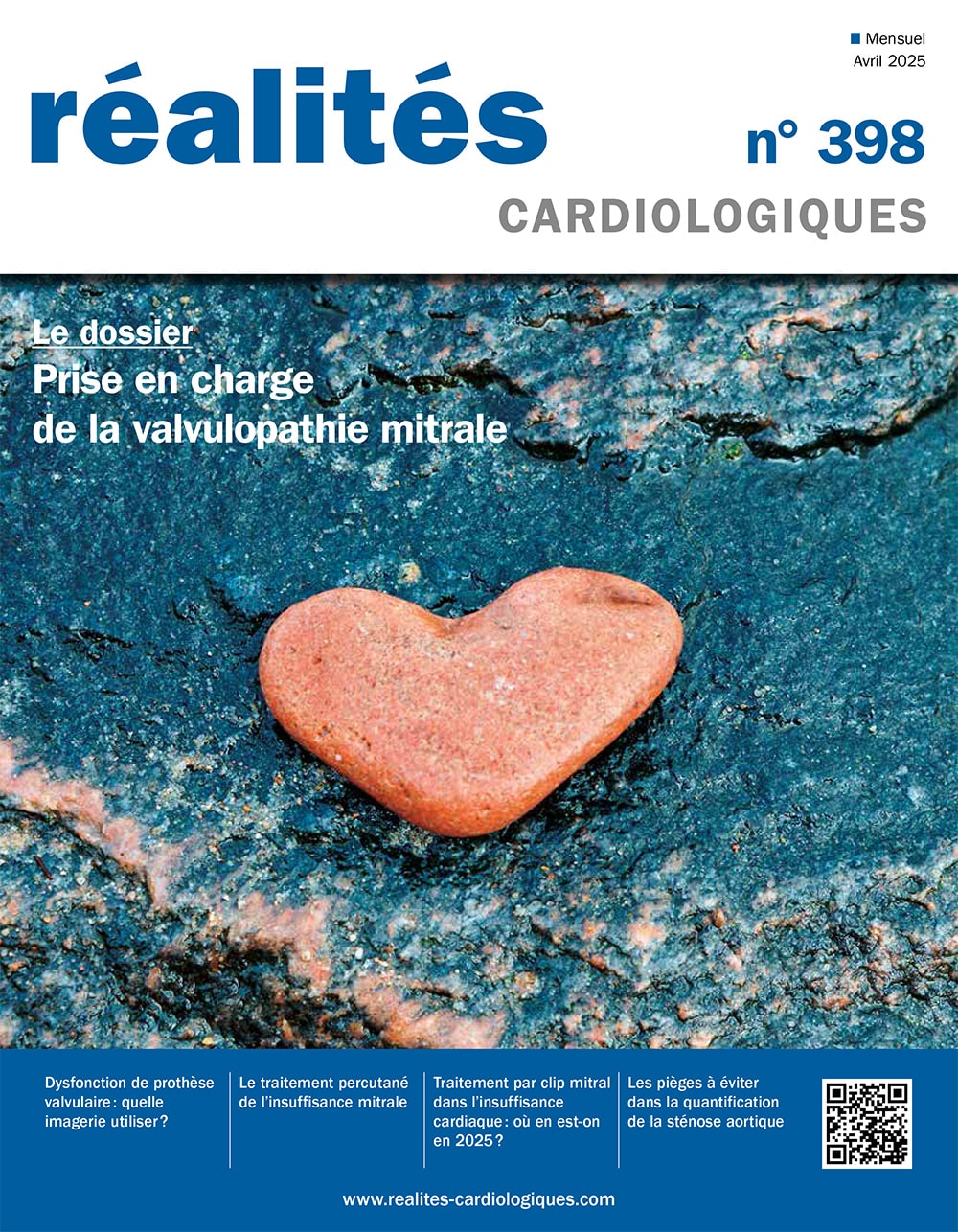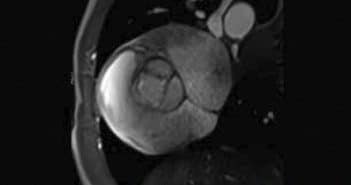Nouvelle stratification du risque cardiovasculaire de la femme française : le consensus “Cœur, artères et femmes” de la SFHTA, filiale de la SFC
Les maladies cardiovasculaires sont devenues en 30 ans la première cause de morbi-mortalité chez les femmes en France. Cette urgence épidémiologique s’explique par le mode de vie délétère des femmes et par des prises en charge insuffisantes. Plus de 80 % des femmes ont au moins deux facteurs de risque cardiovasculaire (FRCV) après 45 ans, facteurs de risque qui sont aussi moins bien contrôlés chez elles. Les femmes sont également exposées à des facteurs de risque hormonaux ou à des situations émergentes à risque.
Les scores de risque classiques ne tiennent pas compte de ces spécificités féminines. Seule la stratification américaine du RCV permet une prise en charge plus ciblée chez la femme. Tout récemment, à l’initiative de la Société Française d’HTA, un consensus d’experts (“HTA, hormones et femmes”) a proposé une nouvelle stratification du RCV de la femme, prenant en compte les FRCV classiques, les facteurs de risque hormonaux et les situations à risque émergentes. Le consensus a pour vocation de guider la prise en charge des femmes et de discuter avec elles, quand cela est nécessaire, de la balance bénéfice/risque de la contraception et du traitement hormonal de la ménopause.