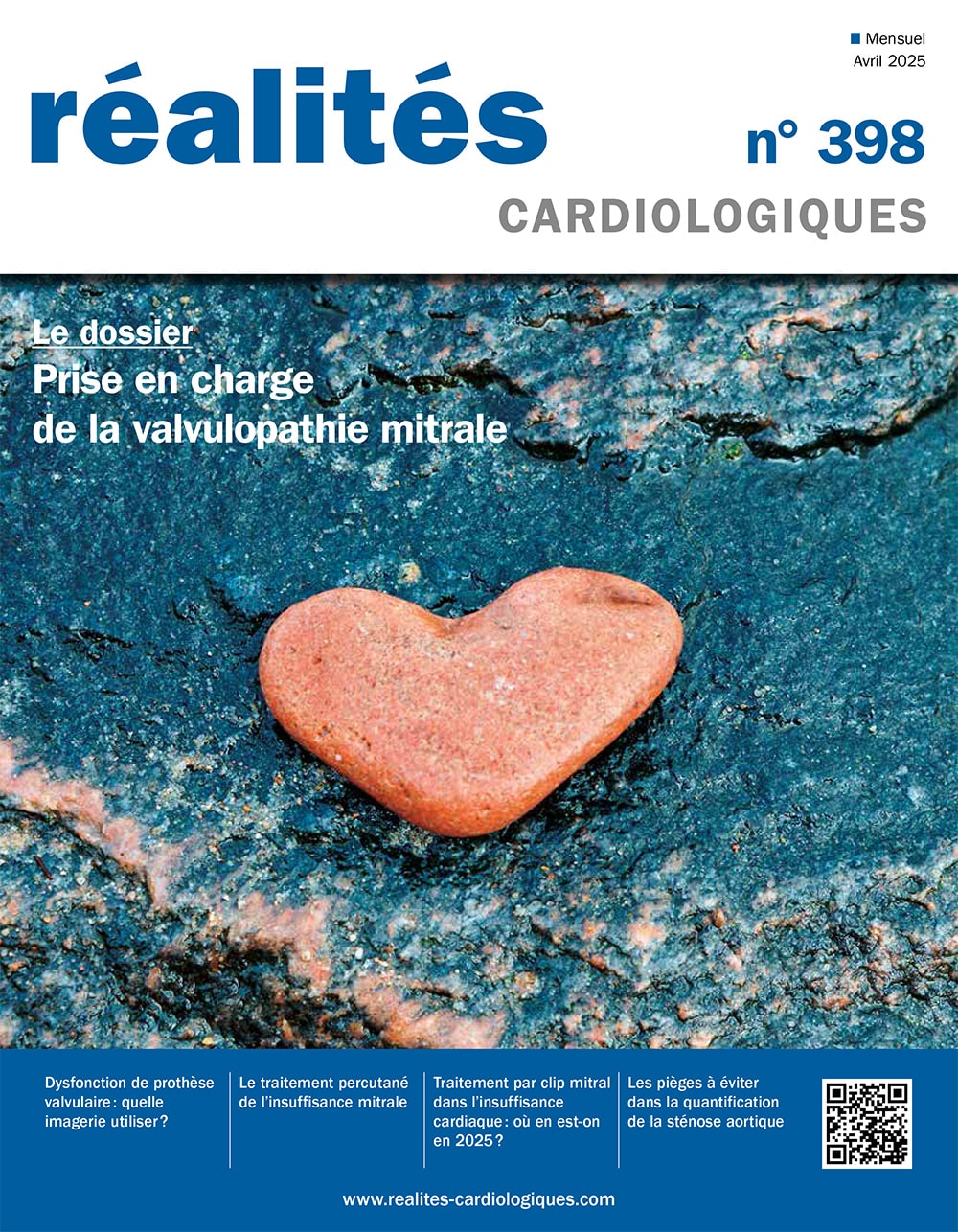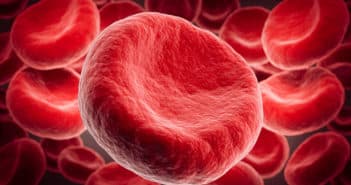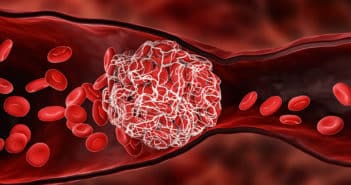Quoi de neuf dans le diabète pour le cardiologue ? Vers la prise en charge cardiologique de l’obésité même sans diabète
L’année 2023 a été très riche en matière de publications dans le diabète. Une requête PubMed effectuée début novembre et ne prenant en compte que les 10 premiers mois de l’année recensait plus de 54 000 publications avec l’item “diabetes”, plus de 36 500 avec l’item “diabetes mellitus” (soit plus de 100 publications par jour), plus de 15 000 avec l’item “type 2 diabetes” et plus de 28 000 avec l’item “obesity”, mais aussi plus de 1 600 avec l’item “gliflozin” et 430 avec le seul item “semaglutide”, c’est-à-dire plus d’une publication par jour concernant une seule molécule.