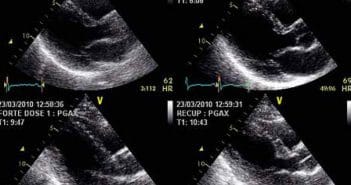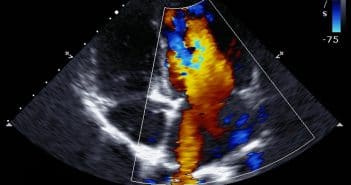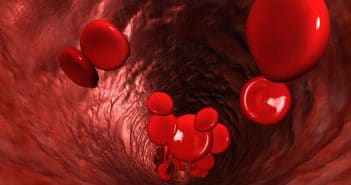Télémédecine dans l’insuffisance cardiaque : où en est-on en France ?
Le télésuivi-accompagnement de l’insuffisant cardiaque grave bénéficiant des développements techniques récents peut transformer le pronostic, diminuer la fréquence et la durée des hospitalisations et donc faire baisser drastiquement le coût de la prise en charge de cette maladie redoutable. À la lumière des premières expériences, certaines préconisations nous semblent devoir être respectées : simplicité pour le patient, respect des professionnels de santé de proximité, dossier informatisé et système expert performant, sécurisation des données et surtout maintien d’un contact humain médical.
Les expériences françaises sont pour l’instant limitées. La plus aboutie, en termes de volume de la cohorte et de recul, a été déployée en Auvergne. Ses résultats remarquables sont, pour l’essentiel, liés à la transformation de l’observance.
Plusieurs études randomisées sont actuellement en cours. Les freins au développement de ce mode de prise en charge sont peut-être en voie d’être levés.