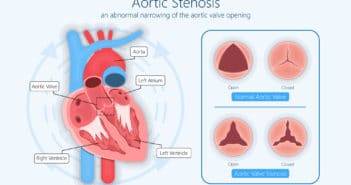Éditorial – Les gliflozines : traitement de l’insuffisance cardiaque
Les sessions scientifiques de la Société européenne de cardiologie (ESC) ont été marquées par deux événements importants en matière d’insuffisance cardiaque. Le premier a été la présentation de nouvelles recommandations pour la prise en charge de l’insuffisance cardiaque. Le second a été la présentation des résultats de l’étude EMPEROR-Preserved démontrant, pour la première fois, qu’un traitement pharmacologique peut améliorer le pronostic de patients ayant une insuffisance cardiaque à fraction d’éjection ventriculaire gauche préservée (IC-FEP). Le dossier de ce numéro de Réalités Cardiologiques est principalement consacré à ces deux actualités et justifie un article spécifique sur les modalités de prescription d’une gliflozine par les cardiologues.