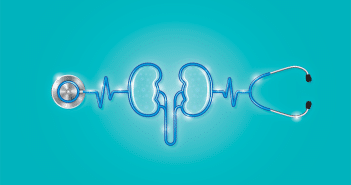
Cœur et rein, un couple de plus en plus indissociable…
L’interdépendance entre le système cardiovasculaire et les reins repose sur…
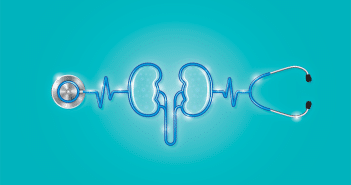
L’interdépendance entre le système cardiovasculaire et les reins repose sur…

La coopération cardiologue-néphrologue est essentielle dans la prise en charge de patients chez lesquels des mécanismes physiopathologiques communs aboutissent à la prescription de médicaments ayant une double action de cardio-néphroprotection.
Cet article propose de revoir de façon synthétique et pratique les situations dans lesquelles l’avis néphrologique peut être requis par le cardiologue, notamment les épisodes d’insuffisance rénale aiguë ou de troubles hydro-électrolytiques volontiers associés à la prescription des diurétiques et/ou des bloqueurs du système rénine angiotensine dans des contextes d’insuffisance cardiaque sévère. Les différentes indications d’adressage sont revues en détail, ainsi que le bilan minimal à envisager pour permettre d’optimiser la consultation néphrologique.

L’hyperkaliémie est une complication fréquente mais contrôlable chez les patients atteints
d’insuffisance cardiaque chronique. Il existe trois étapes clés dans la prise en charge de ce trouble
ionique : 1. la correction des facteurs modifiables (revue des médicaments, apports en sel de potas-
sium et ajustements diététiques) ; 2. l’utilisation des diurétiques, des bicarbonates et des chélateurs
de potassium pour stabiliser les niveaux de potassium, et enfin, en dernier recours ; 3. la réduction ou
l’arrêt des inhibiteurs du système rénine-angiotensine-aldostérone (ISRAA).
Cependant, maintenir les quatre médicaments “fantastiques” (ISRAA, ISGLT2, ARM, bêtabloquants) à
des doses optimales est capital, car leur réduction ou arrêt est associé à une aggravation du pronos-
tic cardiaque et rénal au long cours. L’éducation des patients et la coordination entre les profession-
nels de santé sont les clés pour parvenir à cette gestion optimale.

L’hypertension artérielle (HTA) est un facteur clé dans la progression de la maladie rénale chronique (MRC) et dans le risque cardiovasculaire. Les recommandations sur la cible tensionnelle en MRC ont évolué, passant de seuils différenciés selon la protéinurie (KDIGO 2012) à une cible unique < 120 mmHg (KDIGO 2021), basée principalement sur l’étude SPRINT. Cependant, cette approche a été critiquée pour son manque de généralisation aux patients MRC avancés et diabétiques, ainsi que pour les biais liés à la méthode de mesure de la pression artérielle. En réponse, l’ESH (European Society of Hypertension) 2023 et l’ESC (European Society of Cardiology) 2024 recommandent une approche plus nuancée : un objectif entre 120 et 140 mmHg, ajusté en fonction du profil du patient, notamment l’âge, la protéinurie et la tolérance clinique. En pratique, l’automesure est recommandée pour ajuster la prise en charge. Les objectifs clefs sont un contrôle de la pression artérielle < 130/80 mmHg pour la majorité des patients MRC en automesure, et une PA < 140/90 mmHg pour tous nos patients (à l’exception des patients avec grande fragilité).

Les outils médicaux reposant sur l’intelligence artificielle (IA) peuvent être utilisés à plusieurs étapes du parcours de soin d’un patient. Parmi les utilisations possibles, il y a l’orientation initiale des patients, c’est-à-dire en amont de la consultation médicale, dans un objectif de gradation des priorités et d’identification des situations selon leur degré d’urgence. Ces outils peuvent libérer le médecin de la prise de notes lors de la consultation. Ils peuvent aussi être utiles lors des étapes diagnostiques, en particulier lorsqu’elles nécessitent un examen d’imagerie, ou lors de la prédiction d’un risque. Ensuite, ils peuvent fournir des synthèses aux différentes étapes du parcours du patient, faciliter le suivi médical et permettre de détecter une modification de l’état du patient afin d’adapter son traitement.

Nul doute que la pratique de la médecine en général et celle de la cardiologie en particulier, vont être modifiées par l’arrivée d’outils utilisant l’intelligence artificielle (IA) dans les toutes prochaines années.
Certains médecins qui ont assisté à des présentations concernant ces outils peuvent penser “oui, toutes ces présentations sont du même acabit : on nous en parle, on nous dit que cela va arriver, et finalement, ça n’est toujours pas là. Alors pourquoi s’en préoccuper ?”. “Paroles, paroles, paroles…”

Afin d’aborder ce dossier relatif à l’apport de l’intelligence artificielle (IA) à la pratique médicale, il peut paraître utile de disposer de quelques définitions des termes qui pourront y être employés ou qui pourront permettre de comprendre de quels outils, de quels concepts ou méthodes nous parlons (même si certaines ne font pas l’unanimité).

Quoi ? Encore des articles consacrés à l’intelligence artificielle (IA) ! Et on pressent qu’il y en aura pléthore sur tous les supports possibles dans les mois et années à venir. Encore un effet de mode ?
Non, ce n’est pas une mode. Oui, l’IA est l’outil d’une évolution profonde de notre société et de la pratique de la médecine à moyen, voire à court terme. Pourquoi ?

Pour beaucoup, le prix Nobel de physique de 2024 a été doublement surprenant. D’une part, il a récompensé des travaux concernant l’intelligence artificielle (IA), domaine que l’on pourrait croire éloigné de la physique fondamentale, d’autre part, il a été décerné à des chercheurs dont les travaux majeurs dans le domaine ont été publiés dans les années 1980 et qui ne faisaient pas partie des favoris : John Hopfield (91 ans, Américain) et Geoffrey Hinton (76 ans, Britano-canadien). Leurs travaux ont conduit à une évolution majeure de l’apprentissage des machines numériques et au développement des réseaux de neurones artificiels.

En 2024, les trois prix Nobel scientifiques ont concerné des avancées ayant des implications potentiellement majeures en médecine.
Le 7 octobre, le prix Nobel de physiologie et de médecine a couronné deux chercheurs à l’origine de la découverte des microARN. Le prix Nobel de chimie a été décerné le 9 octobre à trois chercheurs œuvrant sur la structure des protéines. Et, d’une façon qui peut paraître surprenante, le prix Nobel de physique a été remis le 8 octobre à des travaux portant sur l’intelligence artificielle.
