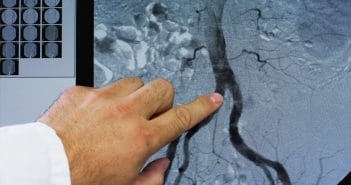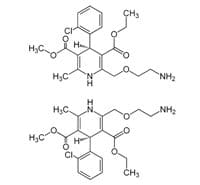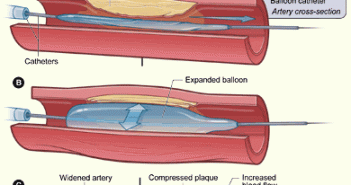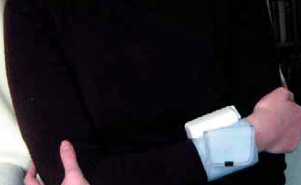Incompétence chronotrope
L’incompétence chronotrope, définie comme l’impossibilité d’accélérer la fréquence cardiaque pour satisfaire les besoins métaboliques, a une valeur pronostique démontrée dans de nombreuses études. Sa correction, parfois par la mise en place d’un stimulateur cardiaque, permet de diminuer les symptômes. En revanche, il n’y a pas de lien établi entre la correction d’une incompétence chronotrope et l’amélioration du pronostic vital.