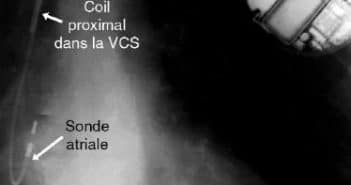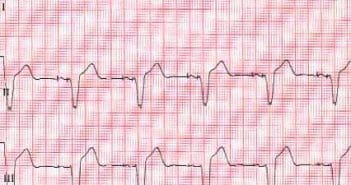Faut-il éviter le jogging après un rhume ?
La localisation myocardique d’une infection virale n’est pas rare. Souvent asymptomatique et difficilement détectable par les examens complémentaires habituels, elle représente toutefois, même dans ce cas, un facteur de risque pour la pratique du sport. D’une part l’activité physique module le système immunitaire, donc la susceptibilité aux infections, et peut aggraver ou retarder l’évolution du syndrome viral. D’autre part, le sport, avec la stimulation sympathique et l’augmentation des catécholamines circulantes qu’il induit, est susceptible de déclencher un trouble du rythme ventriculaire potentiellement fatal. Il apparaît donc raisonnable d’éviter la pratique du sport lors de la phase aiguë fébrile et tant qu’il persiste des courbatures. Après, la reprise sera progressive en volume et en intensité. L’apparition d’une symptomatologie cardiovasculaire impose une exploration complète et l’arrêt temporaire de toute activité physique.