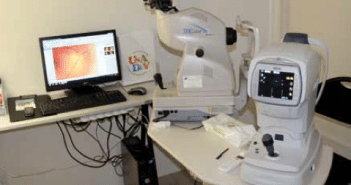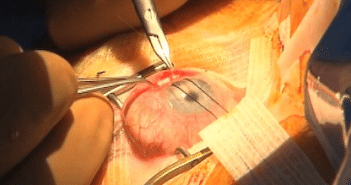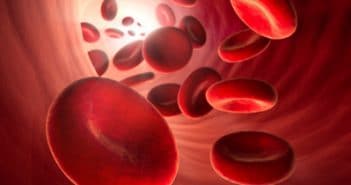AVC ischémique : prise en charge à la phase aiguë
Les accidents vasculaires cérébraux sont une pathologie fréquente et grave dont la prise en charge à la phase aiguë est une urgence diagnostique et thérapeutique. Le traitement s’articule autour de deux éléments fondamentaux, ayant fait la preuve de leur efficacité en termes de diminution de la mortalité et du handicap post-AVC : la prise en charge en unité neurovasculaire (UNV), au sein d’une équipe multidisciplinaire spécialisée et le traitement par fibrinolyse intraveineuse par rt-PA, administré dans les moins de 4 h 30 après le début des symptômes.
Pour augmenter le nombre de patients correctement traités, il faut améliorer la connaissance du grand public, mais aussi du monde médical, aux signes d’alerte et à la conduite à tenir. Le développement de nouvelles stratégies thérapeutiques – pour optimiser la recanalisation artérielle la plus rapide possible – fait actuellement l’objet de nombreux essais.