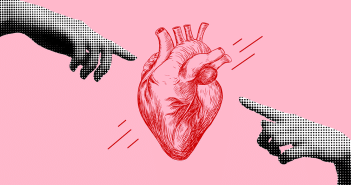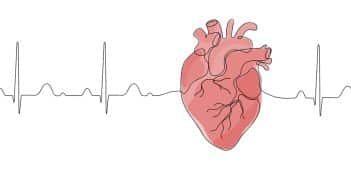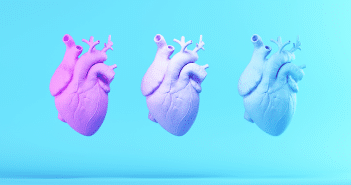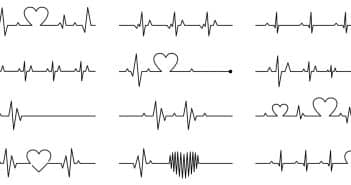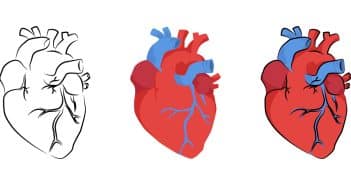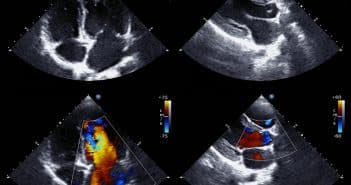Nouveautés en intelligence artificielle ESC 2025
Le congrès de l’ESC 2025 a confirmé la place croissante de l’intelligence artificielle (IA) en cardiologie, avec des applications allant de l’aide à l’utilisation des recommandations à l’imagerie multimodale, la rythmologie, l’interventionnel, la génétique et la recherche clinique. Plusieurs travaux originaux ont été présentés, comme l’outil ESC Chat pour un accès facilité aux recommandations, les modèles multimodaux combinant ECG et échographie, ou encore le recours à la robotisation et aux jumeaux numériques pour améliorer l’accessibilité et la personnalisation des soins. En électrocardiographie, des approches supervisées et non supervisées permettent désormais d’identifier des signaux subtils prédictifs de fibrillation atriale ou d’insuffisance cardiaque.
L’IA a aussi montré son intérêt en cardiologie interventionnelle pour l’évaluation fonctionnelle ou la caractérisation des plaques, ainsi qu’en génétique de la cardiomyopathie hypertrophique (CMH). Enfin, si ces innovations ouvrent de nouvelles perspectives, elles suscitent également des enjeux majeurs de validation, de biais et d’intégrité scientifique.