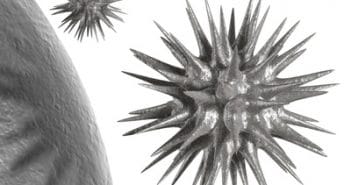Cardiomyopathie dilatée et cardiopathie ischémique : comment faire la différence à l’échocardiographie ?
Le diagnostic étiologique d’une cardiomyopathie dilatée fait partie des objectifs de l’examen échocardiographique qui, lui-même, s’intègre dans le contexte clinique et anamnestique. Schématiquement, deux situations peuvent être rencontrées :
– soit le patient a des antécédents coronariens prouvés et la relation de cause à effet devient évidente, même s’il peut exister des cofacteurs favorisant l’insuffisance cardiaque,
– soit le patient n’a pas d’antécédent coronarien et dans ces cas l’écho de stress à la dobutamine (ou écho d’effort) peut être contributif, mais il faut bien dire que l’échocardiographie à elle seule ne permettra pas en règle d’affirmer ou d’infirmer (sauf cas particulier) la coronaropathie sous-jacente, il est en règle nécessaire dans ces cas de faire une imagerie des coronaires (coronarographie, coroscanner).