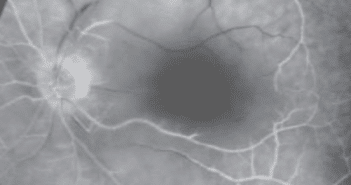Réanimation d’un arrêt cardiaque extrahospitalier : nouvelles recommandations
L’arrêt cardiaque (AC) inopiné – ou mort subite – de l’adulte est un problème majeur de santé publique dans les pays industrialisés, puisqu’il représente 50 % des décès d’origine coronaire et concerne plus de 40 000 personnes par an en France. La survie de ces AC est directement liée à la précocité et à la qualité de leur prise en charge.
Des recommandations internationales pour la prise en charge des AC et des situations pouvant conduire à cet AC sont proposées depuis les années 1960, et sont régulièrement actualisées. La dernière mise à jour date de décembre 2010. Elle met avant tout en lumière l’importance primordiale des compressions thoraciques dans la réanimation cardio-pulmonaire (RCP) qui doivent être réalisées le plus précocement possible par les témoins (guidées par téléphone, si besoin) et ininterrompues jusqu’à l’arrivée des secours, ainsi que de la défibrillation précoce (grâce aux défibrillateurs automatisés).