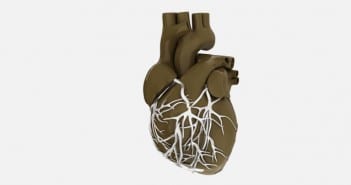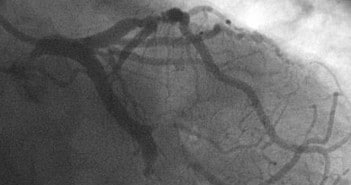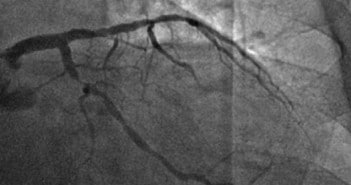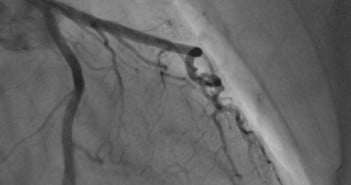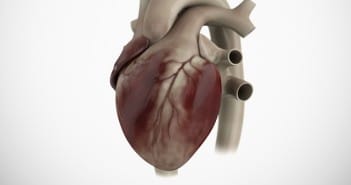Comment utiliser en pratique les outils du sevrage tabagique ?
Un fumeur traverse plusieurs étapes dans sa démarche d’arrêt du tabac : des premières intentions d’arrêt jusqu’au maintien de l’abstinence. Le cardiologue est l’un des professionnels de santé qui compte dans la maturation du projet d’arrêt et dans la motivation du patient. Le dépistage de la consommation du tabac auprès de tous les patients est préconisé ainsi qu’un conseil d’arrêt systématique.
De nombreux outils existent pour aider à évaluer et aider le fumeur. Il est indispensable de mettre en place un soutien psychologique et médical. Parmi les outils thérapeutiques, les traitements nicotiniques en première intention, les médicaments de prescription varénicline et bupropion en seconde intention, mais également d’autres prises en charge existantes ainsi que la cigarette électronique sont évoqués pour établir un partenariat fumeur/cardiologue dans l’arrêt du tabac.
Cet article reprend une communication présentée lors des Journées Européennes de la Société Française de Cardiologie à Paris.