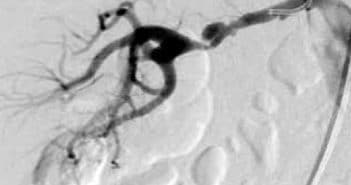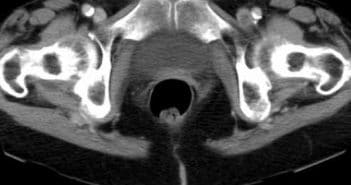Statines après un syndrome coronaire aigu et LDL très bas
Les patients présentant un syndrome coronaire aigu mais avec un LDL-cholestérol bas sont fréquents et l’utilisation des statines a longtemps été discutée dans ce contexte particulier. Si les études spécifiques sont peu nombreuses et surtout avec des effectifs réduits, la réponse à la question de l’utilisation systématique des statines est apportée par l’analyse des sousgroupes des larges études randomisées mais également des grands registres internationaux.