
Quoi de neuf dans le SCA et en cardiologie interventionnelle ?
Cette année a vu de nombreuses communications et publications sur les stratégies de revascularisation.

Cette année a vu de nombreuses communications et publications sur les stratégies de revascularisation.

L’évaluation échocardiographique des patients hypertendus se décline en 4 points cardinaux : le dépistage de l’hypertrophie ventriculaire gauche, l’analyse des fonctions systoliques et diastoliques du ventricule gauche et enfin l’analyse de l’aorte. L’échocardiographie permet de diagnostiquer de manière sensible une cardiopathie hypertensive et d’identifier les éléments de sa sévérité qui vont guider la thérapeutique. L’échocardiographie est également un examen de choix pour dépister les éventuels diagnostics différentiels de l’hypertrophie ventriculaire gauche de l’hypertendu.

Les maladies cardiovasculaires représentent la première cause de mortalité dans le monde. Le risque cardiovasculaire résiduel – qui se définit par le risque d’événements cardiovasculaires persistant malgré des objectifs thérapeutiques atteints en ce qui concerne le LDL-cholestérol (LDL-c), la pression artérielle et l’équilibre glycémique – est souvent associé à la dyslipidémie athérogène (DA). Cette DA, qui est principalement caractérisée par une hypertriglycéridémie à jeun et en postprandial (hyperlipidémie postprandiale), une baisse du HDL-c, une augmentation de la quantité de LDL petites et denses, est fréquemment retrouvée chez les sujets ayant un profil d’insulinorésistance, comme les patients diabétiques de type 2, les sujets présentant un surpoids, une obésité ou un syndrome métabolique.
De nombreuses données épidémiologiques, génétiques et biologiques montrent que l’élévation des lipoprotéines riches en triglycérides reflétée par le dosage sanguin des triglycérides et/ou la mesure du remnant-cholestérol (remnant-c = cholestérol total – LDL-c – HDL-c) représente un facteur de risque causal d’athérosclérose par des mécanismes directs et indirects. Les données des essais cliniques sont moins convaincantes mais des études récentes devraient influer sur les recommandations actuelles.

Avec l’arrivée des inhibiteurs SGLT2, le traitement de première intention de l’ICFEr repose à présent sur les 4 classes médicamenteuses qui diminuent la mortalité et doivent être prescrites le plus rapidement possible après le diagnostic, leur bénéfice apparaissant dès les faibles posologies. Les iSGLT2 se sont révélés efficaces quel que soit le traitement antérieur et ne gênent pas l’implémentation ultérieure des posologies du bloqueur du SRA ou des bêtabloquants, leur effet hypotenseur étant peu marqué. Les recommandations offrent deux possibilités de prescription des ARNi, soit en première intention, le valsartan assurant alors le blocage du SRA, soit en deuxième intention en substitution des IEC, le choix entre ces deux attitudes dépendant essentiellement du niveau tensionnel. Les ARM restent indiqués et constituent un couple idéal avec les diurétiques de l’anse, évitant l’apparition d’une hypokaliémie.
Les différents profils cliniques des patients guideront l’ordre d’introduction de ces traitements qui seront différents dans l’insuffisance cardiaque aiguë ou chronique.
Les traitements médicamenteux de deuxième intention qui diminuent le risque d’hospitalisation se sont également enrichis avec la prochaine mise à disposition du vériciguat pour les patients présentant une aggravation de leur insuffisance cardiaque.
Ainsi, le traitement de l’ICFEr est devenu complexe, nécessitant d’être mis en œuvre par des équipes pluriprofessionnelles spécialisées, comprenant si possible des infirmières formées, participant à la titration, à la surveillance clinique et biologique, aidées par la télémédecine.

Au cours de la fibrillation atriale (FA), un traitement anticoagulant doit être prescrit chez les patients à haut risque thromboembolique (évalué par le calcul du score de CHA2DS2-VASc). Les traitements par anticoagulants oraux directs (AOD) sont indiqués en première ligne dans cette pathologie et les contre-indications ou les adaptations de dose de ces produits tiennent compte de la fonction rénale du patient.
Ces critères, selon les RCP de chaque AOD, doivent être connus et adaptés en fonction de la situation clinique. En cas de sous-dosage inapproprié d’un AOD, il existe un surrisque d’AVC (surtout avec l’apixaban).
Enfin, l’utilisation d’AOD (anti-Xa) diminue le risque de dégradation de la fonction rénale chez les patients souffrant de FA par rapport aux AVK.
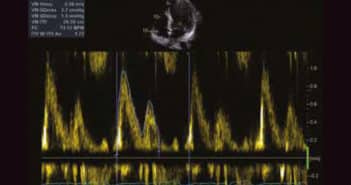
La quantification de l’insuffisance mitrale (IM) primaire (ou organique), dont le modèle est l’insuffisance mitrale par prolapsus valvulaire, repose sur l’échographie transthoracique (ETT). Le caractère primaire ou secondaire de la valvulopathie est parfois difficile à discerner, notamment chez des patients porteurs de valvulopathies restrictives.
En cas d’IM primaire par prolapsus, l’ETT seule suffit généralement pour apprécier le niveau de sévérité de la régurgitation. L’évaluation est basée sur une approche multiparamétrique reposant sur des critères qualitatifs (dont le mécanisme de la fuite), semi-quantitatifs et quantitatifs. L’échographie transœsophagienne (ETO) peut être utile en cas de doute sur la sévérité de l’IM mais aussi pour préciser le mécanisme lésionnel.
La fraction régurgitée volumétrique, obtenue par échocardiographie bidimensionnelle, tridimensionnelle et/ou par IRM cardiaque, est un critère supplémentaire complétant l’évaluation échocardiographique classique et particulièrement utile en cas de paramètres discordants ou si l’examen ETT/ETO n’est pas concluant.

La troponine ultrasensible (hs-cTn) est le biomarqueur de référence pour le diagnostic, la stratification du risque et le traitement des syndromes coronaires aigus (SCA) sans sus-décalage du segment ST. Elle permet d’obtenir une plus grande précision diagnostique et réduit les temps d’observation comparée à la troponine non ultrasensible pour un coût identique.
Les guidelines ESC 2020 pour la prise en charge du SCA sans sus-décalage du segment ST recommandent l’utilisation en première intention de l’algorithme diagnostique 0 h/1 h qui repose sur le dosage répété de la hs-cTn à H0 puis à H1 (classe I, B). En cas de résultats négatifs mais de tableau clinique évocateur ou de présentation précoce (début des symptômes < 1 heure), un dosage supplémentaire à H3 est recommandé. Les niveaux initiaux de troponine apportent en plus des variables cliniques et ECG des informations pronostiques en termes de mortalité à court et à long terme.

L’imagerie multimodalité permet d’épauler l’échographie pour évaluer une insuffisance aortique (IA) et fait partie intégrante des dernières recommandations des sociétés savantes. L’ETT reste au premier plan, suivie par l’IRM en cas d’images de mauvaise qualité ou de résultats équivoques. L’épreuve d’effort ou l’échographie d’effort sont intéressantes pour démasquer les symptômes et pour le suivi du patient.
Si le mécanisme de l’IA n’est pas clair, qu’une chirurgie conservatrice est envisagée, ou que les autres techniques sont contre-indiquées ou non contributives, l’ETO est l’examen de choix. Pour l’analyse de l’aorte, l’ETT est parfois suffisante.
Si une pathologie aortique est évoquée en ETT, une imagerie en coupe est nécessaire (IRM ou scanner), pour décider ou non d’une intervention (particulièrement le scanner), ou pour servir de référence pour le suivi (plutôt par IRM si l’ETT n’est pas suffisante).

Une amylose cardiaque doit être suspectée devant toute hypertrophie ventriculaire gauche ou insuffisance cardiaque à fraction d’éjection préservée. Alors que la présentation clinique est hétérogène en fonction du type d’amylose, une discordance entre un microvoltage à l’ECG et une hypertrophie pariétale à l’échocardiographie, une élévation trop marquée des biomarqueurs cardiaques par rapport au statut clinique et une altération du strain longitudinal global avec un gradient base-apex alors que la fraction d’éjection est préservée sont évocatrices.
Un nouvel algorithme diagnostique, basé sur la scintigraphie aux traceurs phosphatés couplée à la recherche de protéines monoclonales, peut permettre d’éviter la pratique de biopsie dans l’amylose à la transthyrétine, alors que la preuve histologique reste indispensable pour l’amylose AL. Un diagnostic plus rapide permettra une utilisation plus précoce des traitements spécifiques basée sur le typage de l’amylose, seule à même d’améliorer le pronostic de cette maladie. Quant au traitement de l’insuffisance cardiaque, il devra être adapté aux caractéristiques hémodynamiques et rythmiques de l’amylose cardiaque.
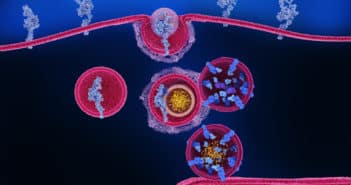
Un patient de 58 ans présente une dyslipidémie mixte en prévention primaire. Il a par ailleurs une hypertension artérielle traitée et contrôlée sous inhibiteur de l’enzyme de conversion (moyenne en automesure : 132/88 mmHg).
