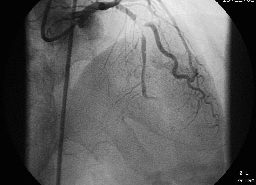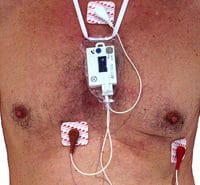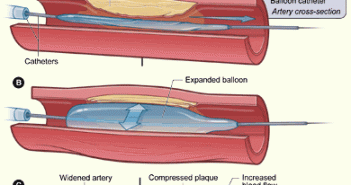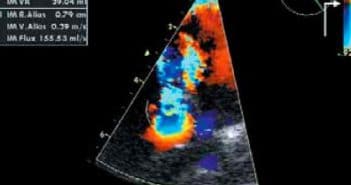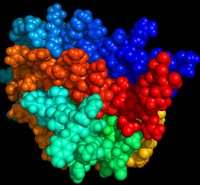
Correction de l’anémie par EPO et risque cardiovasculaire
L’EPO recombinante est un médicament efficace de la correction de l’anémie chez l’insuffisant rénal. Intuitivement, on serait tenté de corriger complètement cette forme d’anémie en raison des nombreux bénéfices théoriques sur le transport de l’O2. Les essais randomisés tant en dialyse qu’en prédialyse viennent contredire cette intuition et indiquent de façon consistante que la cible optimale d’hémoglobinémie sous traitement se situe dans une fourchette de 11 à 12 g/dL. Ces données doivent certainement être prises en compte dans la correction éventuelle de l’anémie associée à l’insuffisance cardiaque compte tenu du risque hypervolémique associé à l’augmentation de la masse globulaire. Des essais randomisés sont nécessaires chez l’insuffisant cardiaque pour valider l’intérêt et la cible de correction de l’anémie par l’EPO.