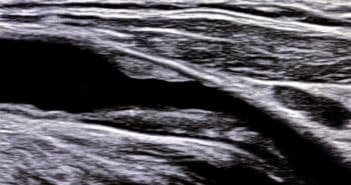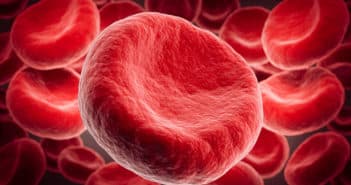Syncopes : tests non invasifs
Les recommandations européennes de 2018 sur la prise en charge des syncopes font un listing complet des examens non invasifs disponibles permettant de faire un diagnostic.
En dehors de la surveillance scopée immédiate des patients à risque, le massage sino-carotidien ainsi que les tests simples d’orthostatisme incluant un enregistrement ECG sont souvent très rentables dans le bilan initial. Le bon sens clinique doit conduire à mettre les patients “en situation” lorsque les syncopes ont lieu dans des circonstances reproductibles (syncopes situationnelles, épreuve d’effort par exemple).
Enfin, il existe de nombreux outils qui permettent un enregistrement continu de l’ECG ; ils doivent être choisis en fonction de la fréquence de survenue des symptômes.