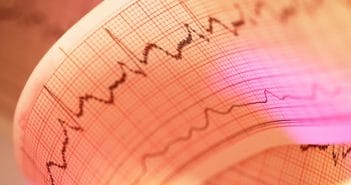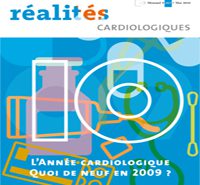
L’Année cardiologique 2010
En 2009, la Société Européenne de Cardiologie (ESC) a publié quatre documents majeurs et l’American College of Cardiology – American Heart Association (ACCAHA) deux mises à jour importantes. Il faut souligner que la présentation des recommandations de la Société Européenne de Cardiologie a été modifiée et uniformisée de sorte que les documents sont devenus particulièrement plaisants à lire. En outre, les documents sont résumés sous forme de ce qu’il est convenu d’appeler des “pocket guidelines”.