Mort subite chez l’adulte jeune : Etude autopsique
Arythmies avant 35 ans et athérome après
Arythmies avant 35 ans et athérome après
Un dépistage systématique est-il toujours d’actualité
Attention aux péricardites tuberculeuses ou purulentes
Efficacité de la prednisone malgré la poursuite du clopidogrel
Une réactivité plaquettaire sous clopidogrel < 208 unités au VerifyNow 12 à 24 h après angioplastie ou lors du suivi diminue le risque cardiovasculaire
Une supériorité largement démontrée

Comment perdre du poids de manière durable ? Cette question nous préoccupe tous. La réalité quotidienne montre à quel point il est difficile d’obtenir des objectifs de perte pondérale réalistes sur le long terme. Notre pratique se heurte à de nombreux obstacles qui paraissent infranchissables : de nombreux déterminants de l’obésité restent à découvrir, ce qui complique l’approche thérapeutique ; les modifications du mode de vie (dont la mise en œuvre manque de moyens) n’ont que peu d’effets persistants sur le long terme ; la prise en charge thérapeutique de l’obésité est un des rares domaines de la pharmacologie qui n’avance guère.

La chirurgie de l’obésité est un domaine en plein développement du fait de la fréquence de l’obésité et des difficultés à obtenir et maintenir une perte de poids suffisante par les modifications du mode de vie. Les indications et contre-indications de la chirurgie bariatrique sont actuellement codifiées uniquement sur la description des niveaux d’IMC pouvant justifier un contrôle chirurgical du poids.
Il n’y a pas de consensus validé sur les indications respectives des techniques existantes selon l’excès de poids, la présence ou non d’un diabète, l’âge… Ainsi, les indications évoluent selon le cumul de l’expérience acquise, ce qui renforce l’intérêt des réunions multidisciplinaires pour poser les indications au cas par cas.
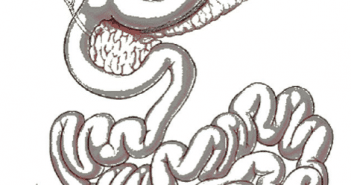
La chirurgie bariatrique a prouvé son efficacité pour corriger sur le long terme l’excès pondéral et les comorbidités associées. Elle ne s’adresse qu’à un nombre limité de patients dûment informés, répondant à des critères médicaux stricts et après une prise en charge spécialisée.
Trois interventions sont pratiquées en nombre égal en France : la pose d’un anneau gastrique ajustable, la sleeve gastrectomie, le by-pass gastrique. Le choix de telle ou telle procédure se fait en prenant en compte différents critères : gravité et ancienneté de l’obésité, âge du patient, difficultés techniques de l’intervention, risques de mortalité et morbidité périopératoires, perte de poids espérée, correction des comorbidités envisageable, possibilité de complications à distance, carences nutritionnelles induites, qualité de vie, souhait du patient.
Il n’y a pas à l’heure actuelle de consensus pour privilégier telle intervention plutôt que telle autre.
Les modalités du suivi doivent être établies dès la phase préopératoire.

Le suivi postopératoire après chirurgie bariatrique est essentiel et doit être poursuivi à vie. Il a pour objectif d’évaluer, chez les patients, l’évolution pondérale et l’absence de reprise pondérale excessive sur le long terme, d’apprécier qualitativement et quantitativement leurs apports nutritionnels et leur comportement alimentaire, de dépister les carences nutritionnelles et vitaminiques et d’éventuelles complications chirurgicales, d’évaluer la nécessité d’un serrage chez les patients porteurs d’un anneau gastrique et l’adaptation des traitements des comorbidités associées à l’obésité.
Chez les femmes, une grossesse ne peut être envisagée qu’après stabilisation pondérale et en dehors de toute carence. La mise en place d’une contraception dans l’année suivant la chirurgie est donc souhaitable. En cas de désir de grossesse, une supplémentation en acide folique est nécessaire en plus du traitement vitaminique habituel. En cas de grossesse, la surveillance reposera sur une surveillance mensuelle du poids de la mère, et au moins trimestrielle du bilan nutritionnel et sur l’évaluation de la croissance régulière du fœtus par les trois échographies obstétricales habituelles.
